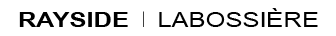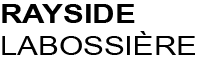De refuge à destination

Chaque année, nombre d’articles de journaux et autres chroniques questionnent de près ou de loin l’avenir du Village Gai de Montréal, en se concentrant principalement sur sa vitalité et sa viabilité commerciale et sur ses problèmes sociaux. Il est vrai que les locaux vacants s’y succèdent, et que la marginalité continue d’y marquer l’imaginaire collectif, en bien comme en mal. Et à travers – voire rassemblant – ces diverses couleurs dont se drape le quartier, le festival de la Fierté se dresse comme événement d’envergure dans la métropole qui attire des dizaines de milliers de personnes, d’ici et d’ailleurs. Mondialement, la ville est reconnue pour son ouverture sur la diversité sexuelle et de genre.
Comment un tel paradoxe peut-il exister? Comment ces deux phénomènes, d’un côté la précarité du milieu et de l’autre son exubérance événementielle, peuvent-ils cohabiter? Une dichotomie semble opposer le local au rayonnement métropolitain. Comment se caractérisent l’un et l’autre de ces niveaux, et où s’ancrent-ils? L’un est-il réel et l’autre mensonge? L’un existe-t-il ou chasse-t-il l’autre, à son détriment? Et, fondamentalement, un – ou même les deux – de ces phénomènes menace-t-il la pérennité du village, et quel phénomène a-t-il permis son existence? Celui-là est-il encore d’actualité, a-t-il évolué?
En 1979, l’Association pour les Droits des Gai(e)s du Québec pose, dès le premier numéro de sa revue de contre-culture Le Berdache, la question de la nécessité de créer un ghetto pour la communauté. Poser la question, à ce moment, c’est y répondre. À cette époque, la communauté, davantage liée au milieu anglophone, est éclatée dans plusieurs lieux du centre-ville, autour des pôles du spectacle et du monde du cabaret et du divertissement pour adultes, univers qui n’a jamais été bien loin de ceux de la marginalité et de la diversité de genre dans le monde. Cet éclatement va d’établissements situés rue Peel jusqu’au célèbre Red Light et à la Main, et la communauté, souvent victime de répression policière, de violence et de discrimination généralisée, navigue entre les soirées hétéros, les bains publics et les bars, selon divers codes et horaires.
L’attrait de la rue Ste-Catherine, dont la réputation plus à l’ouest est déjà bien établie, combiné au faible coût des loyers commerciaux, à la présence de certaines institutions théâtrales de renom et à la construction de la nouvelle Cité des Ondes, dominée par le nouveau siège social de Radio-Canada, sont autant de facteurs qui expliquent l’ouverture de deux nouveaux clubs gais dans le secteur en 1982. Bien que certains commerces fréquentés par la communauté y existaient déjà, il est considéré qu’il s’agit du véritable début du rassemblement de la communauté dans cette partie de la ville. On assiste donc à la naissance, plus ou moins floue, du Village.
La communauté LGBTQ+ n’est pourtant pas indigène au lieu qu’on appelle le Village et dont Tourisme Montréal vante les qualités internationalement, loin de là. Elle s’y est retrouvée pour des raisons probablement fortuites, résolument économiques et par un besoin général de rassemblement de gens partageant une réalité commune.
Comme dans tout village, la notion de famille est importante et c’est avant tout le besoin d’échanges, économiques mais également culturels et sociaux, qui permet d’expliquer les raisons du rassemblement d’un groupe donné en un lieu donné, que ce soit en contexte rural ou urbain. Le Village s’est imposé comme ce lieu de rassemblement en raison de plusieurs facteurs historico-sociologiques ou économiques et ses qualités étaient celles recherchées par la communauté. On pourrait croire que le rassemblement est principalement le résultat d’un besoin partagé de sécurité, tel un château-fort ou un village gaulois, mais ironiquement, le Village n’en demeure pas moins, à ses débuts, un espace dangereux pour ceux qui lui confèrent son identité.

Sortir et fréquenter le village et ses institutions, c’est s’afficher et risquer gros, pour sa carrière, pour ses liens familiaux, et autres. Malgré leur emplacement géographique, les bars et les autres institutions du Village ne sont nullement protégées des descentes policières, bien au contraire. La dernière aura même lieu en 1994. En second, le Village ne rassemble pas une grande famille aimante et bienveillante envers la totalité de ses membres; l’homophobie au cœur même de la communauté existe et discrimine, surtout au détriment des hommes qui ne partagent ou n’affichent pas dans leur apparence et leur comportement certaines qualités propres à la masculinité hétéronormée. Exemple probant de l’époque; certains bars refusent impunément l’accès aux drag queens.
Ce besoin de se rassembler est aussi à la base de la création d’autres villages urbains Montréalais, comme le quartier portugais, la Petite Italie, le quartier chinois, etc. La différence ici est que le Village est un milieu gravitant autour de l’identité sexuelle et l’identité de genre, rendant ses mécanismes et sa perception différents de ces autres quartiers. L’identité du village est, en effet, non pas lié à une religion ou une culture nationale, mais plutôt intimement et inextricablement lié à plusieurs tabous et non-dits, à plusieurs mouvements différents et quelquefois opposés de contre-culture, et à tout autant de préjugés et vérités multiples sur la sexualité humaine et ses niveaux de diversité.

Le Village est un lieu de repère pour certains groupes clés, dans ses meilleures années comme dans les pires. Ces groupes sont surtout composés notamment des jeunes, surtout ceux en provenance de l’extérieur de Montréal et arrivant dans la métropole déracinés; des personnes âgées LGBTQ+ dont la solitude est un enjeu et dont le risque du “retour au placard” l’est tout autant lorsqu’il est question de quitter la communauté; et des personnes les plus marginalisées des minorités de genre et d’appartenance sexuelle, comme les transgenres.
En fait, si le Village est ainsi consacré et autant solidifié géographiquement à ce jour, c’est en partie le fruit du vœu de la ville de Montréal d’en faire un lieu d’attrait touristique, à coup d’encouragements financiers, de subventions diverses et d’interventions artistiques tel que Aires Libres. Cette installation, malgré sa portée bien plus large, prend la forme d’une canopée de boules multicolores dans l’imaginaire collectif et fait de magnifiques cartes postales et son équivalent contemporain, la publication Instagram. Il n’est pas aisé de dire si oui ou non le village serait encore à cet endroit, ni même s’il existerait tout simplement si Montréal n’avait pas décidé d’en faire un produit promotionnel touristique.
De fait, Tourisme Montréal fait la promotion du Village Gai dès 1993. L’espace devient une attraction pour la communauté gaie et ce, mondialement. C’est par cette transformation que le quartier, et surtout la rue Ste-Catherine, perd, petit à petit, son caractère d’artère commerciale de proximité dans un quartier résidentiel historiquement défavorisé. C’est aussi par cette consécration “événementielle” que l’artère principale du quartier en devient une de festivités continuelles, dédiée au divertissement, à la restauration, à l’hôtelier ainsi qu’à l’art public dans une moindre mesure. Non sans confrontation avec le caractère résidentiel, dont la quiétude et les activités quotidiennes sont considérablement affectées par les désagréments de tels usages, et par l’éloignement de certains services et commerces locaux.

En ce sens, les quartiers traditionnels, habités par une seule communauté, ont-ils encore leur place dans la ville du XXIe siècle? Dans une ville ouverte et mondialisée, il ne semble à priori plus nécessaire pour une population immigrante, ouvrière ou marginalisée de se regrouper en un seul endroit dans l’espace urbain. Les réseaux de support qui concentraient jadis ces communautés au sein d’un même quartier peuvent aujourd’hui s’opérer à des échelles plus larges, et tout nouveau regroupement fondé sur une base ethnique ou religieuse s’apparenterait à une certaine ghettoïsation.
Plusieurs des quartiers immigrants de Montréal ne sont plus le lieu principal de résidence de leur communauté fondatrice: Italiens, Portugais, Grecs et Chinois habitent de nos jours à travers l’ensemble de la région métropolitaine et leurs trajectoires résidentielles épousent celles des Québécois de toutes les origines. Cependant, plusieurs continuent de fréquenter de façon ponctuelle le quartier d’origine de leur communauté respective, attirée par une offre commerciale particulière, voire par des attraits événementiaux et architecturaux qui font revivre cette identité. Comment favoriser cette nouvelle façon de concevoir le quartier traditionnel sans pour autant se livrer à une muséification qui en dénaturerait le caractère authentique et excluraient les nouvelles populations qui les ont investis?
Lisez la seconde partie dans notre article du mois d’octobre!